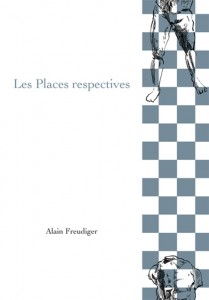 Ce roman, qui narre les tribulations lausannoises de Akim et de Mika, est marqué par le thème de l’impossible communication : les protagonistes évoluent dans un monde ennuyeux et caractérisé par une certaine absurdité, ils semblent déconnectés, plus ou moins spectateurs de cette vie qui se déroule autour d’eux. L’auteur a choisi d’incruster au fil du récit des sortes d’ « instantanés textuels » (slogans publicitaires, tags, citations, extraits de textes de toute nature), dans une technique proche du collage surréaliste : ce faisant, il parvient à retranscrire cet effet de saturation que semblent ressentir les protagonistes, noyés au milieu d’un univers de signes et de messages qui finissent par entraîner quelque chose de l’ordre de la nausée.
Ce roman, qui narre les tribulations lausannoises de Akim et de Mika, est marqué par le thème de l’impossible communication : les protagonistes évoluent dans un monde ennuyeux et caractérisé par une certaine absurdité, ils semblent déconnectés, plus ou moins spectateurs de cette vie qui se déroule autour d’eux. L’auteur a choisi d’incruster au fil du récit des sortes d’ « instantanés textuels » (slogans publicitaires, tags, citations, extraits de textes de toute nature), dans une technique proche du collage surréaliste : ce faisant, il parvient à retranscrire cet effet de saturation que semblent ressentir les protagonistes, noyés au milieu d’un univers de signes et de messages qui finissent par entraîner quelque chose de l’ordre de la nausée.
La musicalité de l’écriture de Freudiger est à souligner: certains passages particulièrement travaillés se lisent comme une chanson, quelque chose comme du rap ou du slam, et gagnent à être déclamés à haute voix. Les jeux de mots et jeux de l’esprit, les assonances et les cassures du rythme donnent une tonalité à la fois urbaine et poétique au récit :
Les soirées mondaines ça s’enchaîne et ça coule, connaissances ici et amis là — je reste toujours dans le mouvement, il faut surtout pas perdre pied si on veut pas s’embourber, deux soirées loupées et on est lourdés — les infos circulent dans les ruelles, jamais d’invitation officielle, il faut être là au bon moment, cueillir l’appel argent comptant, rester dans le flux, au pire lancer des appels si on craint de manquer, téléphone portable, dernière chance potable, sans quoi on perd son tour de table, on est largué misérable, […]
Toujours d’un point de vue stylistique, on a également apprécié le jeu de miroir en « je » et en « tu » autour des deux personnages principaux, dispositif original et qui permet de donner une certaine dynamique à l’ensemble.
Reste que malgré les innovations formelles de l’auteur, la lecture de ces places respectives s’avère parfois fastidieuse : assez vite, l’intrigue se fait désirer. Il manque quelque chose comme une ligne directrice autour de laquelle puisse s’échafauder le roman. On se demande où veut nous emmener l’auteur, de sorte qu’arrivé au milieu du livre (300 pages au total, tout de même), on se demande encore quand celui-ci va vraiment commencer. Certes, indiscutablement ce roman nous parle d’aujourd’hui, de la vie d’aujourd’hui, il nous dit, souvent avec finesse, ce que peut signifier vivre à Lausanne dans les années 2000 quand on a trente ans. Les habitants du coin apprécieront de reconnaître les lieux mythiques de la ville, comme autant de clins d’œil. Mais au final, le livre donne l’impression d’une succession de petites histoires, une sorte de cahier de notes d’une vie, autant de scènes souvent dépeintes avec talent, mais qui peine à s’articuler et à former un ensemble. Plus d’une fois, on aurait attendu de la lumière, une étincelle, une surprise, une rupture de la narration, quelque chose qui vienne bousculer les choses et redonner du souffle au récit… L’ouvrage refermé, reste la question du « pourquoi » : quel est l’enjeu du livre ? Pourquoi l’auteur l’a-t-il écrit ? Qu’a-t-il voulu dire ?
Ce type de littérature de la solitude urbaine et d’une certaine banalité du quotidien peut sans doute se passer d’une trame forte si, et seulement si, la dimension sociologique est particulièrement soignée : c’est l’une des recettes d’un Michel Houellebecq, qui parvient, avec une certaine économie de moyens, à parler avec intelligence du temps présent, des rapports humains, des rapports de sexe et de classe, du monde du travail… Cette dimension théorique aurait gagnée à être plus travaillée chez Freudiger.
A propos des personnages, le jugement est ici encore en demi-teinte : certes, leurs réflexions sonnent le plus souvent juste, certes ils illustrent cet individualisme caractéristique, cette difficulté à tisser des liens… Mais faut-il vraiment qu’ils répondent à tous les clichés du genre trentenaire blasé-urbain-bobo-séducteur? Si l’auteur est évidemment libre de ses choix créatifs, et libre d’imaginer ses personnes comme il l’entend, on regrette par exemple d’éprouver un sentiment de déjà-lu face à Akim, journaliste s’ennuyant au job la journée, côtoyant des gens forcément insupportables, DJ écumant les lieux branchés de la ville et les soirées forcément « un peu molles », séduisant des femmes toujours belles, jeunes et désirables. Ce côté finalement assez convenu et prévisible de leur psychologie fait qu’on peine à s’attacher aux personnages, si bien que leur ennui et leur « déconnexion » finissent par gagner le lecteur et les lui rendre antipathiques.
Au final, « les places respectives » laissent un sentiment mitigé : ce type de récit du quotidien et de sa banalité (l’ennui au travail, l’ennui dans le bus, l’ennui dans les bars…) ne tolère aucune lenteur, au risque de susciter chez le lecteur l’ensemble des sentiments ressentis par les protagonistes. On retiendra néanmoins chez Freudiger cette rythmique très « rap » dans la phrase, à la fois efficace et très maitrisée. Malgré cet indéniable talent de « musicien de la prose », malgré une faculté réelle de décrire le monde dans lequel nous vivons, l’auteur trébuche sur l’absence d’enjeu : gageons qu’un texte écrit de la même manière mais resserré, — allégé d’une bonne moitié et conservant ce phrasé musical rapide et incisif — aurait été plus percutant.
Alain Freudiger
Les places respectives
Castagniééé, 2011
300 pp.
L’auteur : Alain Freudiger est né en 1977. Il a étudié l’histoire du cinéma et a travaillé comme critique pour la défunte revue « Film ». Auteur d’un premier roman paru en 2007, il est lauréat cinq ans plus tard du prix « Naples raconte », décerné par l’Université de Napoli-L’Orientale, pour une nouvelle inédite, Molly.
